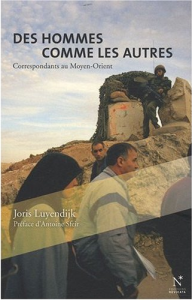
Joris Luyendijk a été plusieurs années correspondant au Moyen Orient d’abord pour le Volksrant, le 3e quotidien néerlandais, et une radio, puis pour un grand quotidien de référence, le NRC Handelsblad, et une télévision du service public, la NOS. Un travail apprécié, récompensé en 2002 par une Plume d’Or [Het Gouden Pennetje] et son élection comme « Journaliste de l’année« , par l’Association néerlandaise des journalistes [site ici]. Il travaillera d’abord au Caire, puis s’installera en Israël. Une expérience professionnelle variée, qu’il retrace dans Des Hommes comme les autres:
J’avais été surpris et flatté lorsque le Volkstrant et la radio m’avaient proposé d’être leur correspondant. Je m’étais persuadé qu’ils avaient, tout simplement, une énorme confiance en moi (…) Mais la véritable raison de leur audace en me choisissant, était moins flatteuse: le travail de base d’un correspondant n’est pas très compliqué. La rédaction aux Pays-Bas appelait pour signaler que quelque chose s’était produit, ils faxaient ou envoyaient les dépêches par courriel, je les reproduisais dans mes propres termes. Voilà pourquoi ma ma présence sur place était plus importante pour les rédactions que mes informations personnelles (…) Je ne me rendais pas sur place pour constater ce qui se passait. Je ne me rendais sur place que pour y être le présentateur de l’information à transmettre.
Dès les premières lignes Des Hommes comme les autres, Joris Luyendijk détruit l’aura qui entoure le correspondant et nous fait passer dans les coulisses de ce qui ressemble à du très mauvais théâtre. La nuit où commencèrent les bombardements américains sur Bagdad, prélude à la guerre d’Irak, il se trouve à… Amman, faute d’avoir obtenu un visa. Il ne respecte pas la bonne dateline [l’endroit d’où est réalisé un article, un reportage télé, un commentaire radio, etc. ], qui était alors Bagdad. Mais qu’importe. Il se lance. L’émission radio dure des heures, avec une intervention de sa part pratiquement à chaque heure. Les questions qu’on lui pose depuis la Hollande sont précises. Les réponses qu’il apporte le sont autant: pas d’hésitation, des réponses toujours exactes. À un ami qui s’étonne, il explique « toutes ces questions sont préparées à l’avance, comme c’est le cas au journal télévisé ».
Mieux, ou plutôt pire. Il découvre que ses supérieurs aux Pays-Bas savent mieux que lui —le-correspondant-sur-place— ce qui se passe dans la région, qu’il est censé couvrir !
L’inutilité du correspondant ainsi démontrée —si ce n’est le fait qu’il « est sur place »— pour l’information « chaude », que lui reste-t-il à faire? L’analyse et le reportage, répond Joris Luyendijk. Mais là aussi, malaise.
Malaise, car en dépit de ses efforts ses articles ne font que renforcer les stéréotypes véhiculés en Europe sur le monde arabe:
Non seulement mes articles ne reflétaient pas mes expériences positives du monde arabe, mais je contribuais même à répandre l’image d’Arabes sinistres, dangereux et bizarres. L’organisation des actualités fait que j’écrivais sur les « hommes en colère » qui brûlaient des drapeaux et scandaient des slogans, mais je ne disposais pas d’espace pour y ajouter ce qui se déroulait hors-champ (…) Je ressentais la déformation le plus fortement dans mes articles sur les femmes (…) Il y avait de superbes citations, par exemple celle de ce juge à Alexandrie qui avait permis à un homme de divorcer de son épouse obèse en indiquant qu’on éprouve peu de plaisir avec une femme grasse (…) Ces articles marchaient toujours, mais je contribuais à répandre l’image d’Egyptiennes pitoyables et opprimées, ce qui ne correspondait pas à mon expérience quotidienne. Lorsque j’avais demandé à des étudiantes si elles se sentaient opprimées, la plupart avaient éclaté de rire. Et en tant que correspondant il m’était de nouveau clairement apparu que les Egyptienne se sentent tout sauf des victimes.
En fait l’explication de cette « déformation », tient à la manière dont est conçue l’information elle-même et son lien à l’actualité. Celle-ci, pour reprendre une pseudo évidence est ce qui tranche avec l’ordinaire, l’exception. C’est le fameux « on ne parle des trains qui arrivent à l’heure, mais seulement de ceux qui sont en retard ». Problème, explique Joris Luyendijk, lorsqu’il s’agit de traiter de sujets aussi mal connus dans les pays occidentaux que le monde arabe, l’image qui en ressort dans les médias ne peut qu’en être fortement déformée.
Si la démocratie est une voiture, la dictature est une vache ou un cheval
Comme si cela ne suffisait pas, il va se trouver confronter à un autre écueil de taille: il est impossible pour un journaliste de travailler sous une dictature. Un fait qu’ignore les lecteurs, car,
cela n’apparaît pas parce que les médias occidentaux et les scientifiques en parlent comme ils parlent de démocratie. On appelle « président » le dictateur de l’Égypte (…) Ce dictateur dirige le « Parti National-Démocrate », qui n’est ni démocratique ni un parti. »
En fait insiste-t-il:
En arrivant au Caire comme correspondant, je considérais les méthodes journalistiques comme une sorte de trousse à outils utile partout à travers le monde. Mais la dictature et la démocratie ne sont pas comme deux voitures de marques différentes. Si la démocratie est une voiture, la dictature est une vache ou un cheval. Celui qui l’aborde avec un tournevis ou un fer à souder est totalement désarmé.
Il manquait à Joris Luyendijk une dernière expérience, celle de la guerre, plus précisément celle de la guerre des médias. Elle va se dérouler en Terre Sainte, comme il se résout à appeler Israël et la Palestine, dans un souci de neutralité. C’est l’objet de la 2e partie de son livre.
Dans cette guerre, il y a des « faits »: opérations militaires, attentats, occupation, nouveau ministre, etc. Mais comment en rendre compte « sans être partial » ? Tout est piège. Les termes utilisés, par exemple: « Les Palestiniens qui usent de la violence contre des civils israéliens sont des ‘terroristes‘, des Israéliens qui usent de la violence contre des civils palestiniens sont des ‘faucons‘ ou des ‘durs‘. »
Cette « guerre des mots » recouvre d’autres pièges. Une seule journée, un seul événement, explique-t-il, donne lieu à des récits totalement différents de la part des protagonistes. Comment choisir ? La réponse des médias occidentaux, à l’époque où il était correspondant, tenait dans la formule « he says, she says« , chère au journalisme américain. Cela donnait, par exemple: « Selon le gouvernement israélien, l’attentat montre à nouveau que les Palestiniens ne veulent pas la paix. Selon les autorités palestiniennes, c’est l’occupation qui est le problème. » Impartial? En apparence seulement, car « ce rétrécissement de la perspective mettait le doigt sur un autre problème de l’impartialité: on peut prétendre ne rapporter ‘que les faits‘, mais quels faits? On peut se targuer de laisser s’exprimer une opinion et une contre-opinion, mais à qui permet-on de s’exprimer, et à qui refuse-t-on?
Pour attirer le « vote de sympathie », essayer de renverser la question de la culpabilité
Et ce n’est pas tout. La guerre des médias ajoute-t-il, porte aussi sur un autre enjeu, le sympathy vote [vote de sympathie]. « Le public s’identifie généralement aux plus faibles, écrit-il, donc toutes les parties tentaient de manœuvrer pour s’octroyer la position du perdant. » Face à cette logique, comment rester neutre? Mission d’autant plus redoutable que les moyens des deux parties en présence sont totalement dissymétriques. D’un côté —celui des Israéliens— une machine de communication rodée, efficace. Par exemple, lorsque seront diffusées des images d’enfants, de femmes ou de vieillards palestiniens tombant sous des balles israéliennes, immédiatement, « les Israéliens déclaraient apparemment en toute franchise (…) qu’ils avaient ‘honte de leur pays’, et qu’il fallait enquêter à fond sur cette bavure de l’État juif. (…) Ensuite, ces mêmes porte-paroles expliquaient que la confusion dominait bien des ‘situations de combat’ dans les ‘territoires contestés‘ (…) Les terroristes se cachaient intentionnellement dans les quartiers d’habitations en espérant qu’Israël tue accidentellement des civils palestiniens ».
Et il analyse :
C’était la façon des gouvernements israéliens de minimiser les dommages: ne pas aborder la question de l’occupation, de prendre ses distances par rapports aux événements, de les isoler comme une exception, de semer le doute sur le déroulement des événements et de renverser la question de la culpabilité… »
Côté palestinien, outre une profonde désorganisation du système de relations publiques, les interlocuteurs palestiniens de Joris Luyendijk pointent une autre difficulté: « L’échec de la gestion des médias [par les Palestiniens] était la conséquence directe de l’attitude autoritaire des autorités palestiniennes (…) Nos porte-paroles ne se préoccupent pas d’une gestion médiatique exemplaire, mais de plaire au Leader [à l’époque Yasser Arafat] ».
Et l’on retombe encore sur la question de la dictature et de l’inadéquation des outils dont disposent les journalistes pour en rendre compte.
Le livre de Joris Luyendijk qui a connu un énorme succès de vente aux Pays-Bas a suscité de violentes réactions de la part d’une partie des journalistes néerlandais, reprises pour l’essentiel dans Het maakbare neiuws. Antwoord op Joris Luyendijk, [L’information possible, réponse à Joris Luyendijk] publié sous la direction de M. van Hoogstraten et E. Jinek. [Balans, Amsterdam, 2010, 256 pages].
Une sorte d’Alice tombée dans un monde qui n’est pas le sien?
Au cœur de ces accusations, le fait que Joris Luyendijk [qui ne s’en cache d’ailleurs pas] était un débutant, manquant d’expérience professionnelle et connaissant mal la région. « Il est une sorte d’Alice tombé dans un monde qui n’est pas le sien », écrivent cruellement ses contempteurs.
Reste une dernière question Joris Luyendijk élève-t-il trop haut les standarts professionnels, a point de les rendre inaccessibles ? Peut-être, mais peut-on reprocher à un journaliste d’être « trop » exigeant? Le mérite Des Hommes comme les autres est en tout cas d’interroger le journalisme dans sa pratique. Une nécessité comme, il l’écrit dans sa conclusion:
Le journalisme parle du monde, et donc le journalisme doit également parler du journalisme, car celui-ci fait partie du monde. Les médias contrôlent le pouvoir, mais les médias ont également du pouvoir. Un des principes de la démocratie et que tous les pouvoirs doivent se justifier, et c’est en partant de cette pensée que j’ai écrit ce livre.